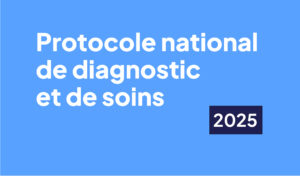Résumé
L’insuffisance respiratoire chronique (IRC) constitue une complication possible de plusieurs pathologies respiratoires rares de l’enfant. Elle apparait lorsque l’appareil respiratoire devient incapable d’assurer les échanges gazeux avec le sang qui se produisent au cours de la respiration – apport de dioxygène [O2] et élimination du dioxyde de carbone [CO2].
Les pathologies respiratoires de l’enfant qui peuvent évoluer en une IRC sont nombreuses, et comprennent entre autres :
- Pneumopathies interstitielles chroniques, dont :
- Pathologies bronchiques et bronchiolaires, dont :
- Dyskinésie ciliaire primitive – DCP
- Mucoviscidose
- Anomalies du développement, dont :
- Dysplasie broncho-pulmonaire – DBP
- Syndromes d’hypoventilation alvéolaire, dont :
Quelles sont les personnes concernées ?
La recherche d’une IRC se fait chez les patients déjà suivis pour une pathologie respiratoire chronique.
Quels sont les symptômes de la pathologie ?
Les symptômes liés à l’IRC elle-même peuvent parfois être difficiles à différencier de ceux liés à la maladie sous-jacente.
Pour cette raison, il est essentiel de bénéficier d’un suivi spécialisé qui permette un repérage précoce de l’IRC et la réalisation des examens qui la confirme. Les symptômes évocateurs sont :
- une difficulté à respirer : également appelée dyspnée, elle se manifeste par un essoufflement d’abord à l’effort puis au repos, ou par l’impression de manquer d’air
- une respiration rapide et permanente : également appelée polypnée, elle se manifeste principalement chez le nourrisson – souvent accompagnée d’une difficulté à la prise de biberons
- une apparition de dépression du thorax lors de la respiration (également appelé « tirage »), notamment chez le nourrisson
- une altération de la croissance en poids, liée à la grande quantité de calories dépensées pour faire face aux difficultés respiratoires
des maux de tête au réveil, sueurs nocturnes excessives, somnolence, confusions et/ou tremblements de mains : conséquences directes de la perturbation de la concentration en CO2 dans le sang, également appelé hypercapnie
Quels examens doit-on passer pour le diagnostic ?
Le diagnostic formel d’une IRC se pose lorsqu’on observe une diminution du taux de dioxygène dans le sang, à plusieurs reprises pendant la journée, au repos, et en dehors de toute aggravation passagère de la pathologie existante. Cependant, dans la pratique, mesurer le taux d’oxygène et de gaz carbonique par un prélèvement sanguin artériel, ou artérialisé au lobe de l’oreille, est difficile à réaliser chez l’enfant.
Des mesures plus simples et non invasives permettent d’évaluer une diminution d’apport en oxygène ou une augmentation du gaz carbonique. Il s’agit de la mesure transcutanée de la saturation en oxygène (SpO2) et du gaz carbonique. Ces mesures sont réalisées par un enregistrement continu au cours d’une nuit et permettent de décider si un apport supplémentaire en oxygène est nécessaire, la nuit ou toute la journée, ou si une ventilation non invasive nocturne est nécessaire à domicile.
Il est nécessaire de compléter ces mesures par des explorations fonctionnelles respiratoires et un test de marche de 6 minutes chez les enfants qui sont capables de coopérer, ainsi que par une échographie cardiaque pour mesures les pressions artérielles pulmonaires.
Quelle est la prise en charge ?
La prise en charge repose à la fois sur l’amélioration et surveillance des fonctions respiratoires et la mise en place de mesures hygiéno-diététiques. Elle a plusieurs objectifs :
- soulager les symptômes
- améliorer la qualité de vie
- éviter et traiter les complications et les exacerbations
- maintenir l’insertion scolaire et/ou permettre le retour rapide aux activités sociales
Traitement médical
Divers traitements médicaux permettent de soulager et de contrôler les symptômes respiratoires de l’IRC et contribuent à améliorer la qualité de vie des patients.
Oxygénothérapie de longue durée (OLD)
Elle est mise en place dès constatation de valeurs de SpO2 nocturnes en dessous des valeurs seuils L’OLD peut être prescrite uniquement durant le sommeil, mais est parfois également nécessaire à l’éveil, notamment durant les efforts.
Avec cette mesure, le retour de l’enfant à domicile est possible mais doit être bien préparé en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de soin.
Ventilation non invasive au long cours
La ventilation non invasive (VNI) inclut la pression positive continue (PPC) et la ventilation non invasive proprement dite.
Elle est indiquée en cas de constatation de syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) sévère et persistant, ou d’hypoventilation alvéolaire avec augmentation du gaz carbonique, quelle qu’en soit la cause.
Elle est réalisable au long cours à domicile à tout âge, du nouveau-né au jeune adulte. Certaines particularités liées à l’âge concernent le choix de l’équipement, les réglages, et la surveillance.
Activité physique adaptée
L’activité physique adaptée (APA) est une pratique encadrée, personnalisée, destinée à améliorer la santé et la qualité de vie des patients atteints de pathologies respiratoires chroniques.
En effet, les enfants avec IRC diminuent fréquemment leur niveau d’activité physique. Dans ce cadre, un bilan personnalisé est recommandé pour établir les objectifs ainsi que les modalités de prises en charge.
Ces bilans sont réalisables par des professionnels de la réhabilitation – comprenant les enseignants en APA, les kinésithérapeutes ou encore les éducateurs sportifs. Ils peuvent intervenir à domicile, dans des maisons sport santé, dans des salles de sport santé, et parfois en hospitalisation conventionnelle.
Prise en charge nutritionnelle
Maintenir un état nutritionnel optimal est un objectif essentiel de la prise en charge d’un enfant avec IRC.
Un suivi diététique régulier permet de garantir un apport en calories suffisant et équilibré. Parfois, une alimentation par sonde (ou nutrition entérale) peut être nécessaire.
Des difficultés liées à la prise de nourriture, également appelés troubles de l’oralité, peuvent compliquer la prise en charge nutritionnelle. Elles sont plus fréquentes chez le nourrisson. Elles peuvent être traitées de manière spécifique par des équipes spécialisées, notamment des orthophonistes.
La transplantation ou greffe pulmonaire
Chez les patients atteints d’une IRC très invalidante, avec une baisse importante de la qualité de vie, les médecins peuvent proposer une transplantation ou greffe pulmonaire. Les indications sont discutées au cas par cas au sein de réunions de concertations pluridisciplinaires.
L’objectif principal est d’éliminer le handicap respiratoire afin d’améliorer la qualité de vie de l’enfant, tout en prolongeant sa survie. Cette option thérapeutique n’est envisagée que lorsque toutes les autres alternatives ont échoué. Sa réalisation de fait au sein de centres très spécialisés, qui ont un agrément de l’Agence de Biomédecine.
Les mesures hygiéno-diététiques
Mesures préventives
Les « mesures barrières » doivent être respectées (lavage des mains, gel hydroalcoolique, port du masque, …), pour limiter le risque d’infection virale. Il est également conseillé de limiter la fréquentation par l’enfant des lieux très fréquentés pendant les périodes épidémiques (transports en commun, grandes surfaces, …).
Bien que le port du masque soit difficile pour l’enfant en permanence, notamment à l’école, il peut être envisagé au cas par cas et est conseillé dans les transports en commun. Pour les nourrissons atteints d’IRC, il demeure recommandé de retarder l’entrée en collectivité et d’éviter les modes de garde collectifs.
Il est également essentiel de réduire la pollution de l’air intérieur et notamment d’interdire toute exposition au tabac.
Vaccination
Les enfants avec IRC doivent bénéficier d’une protection vaccinale renforcée, qui doit tenir compte des traitement reçus pour la pathologie sous-jacente.
En l’absence de traitement immunosuppresseur, le calendrier vaccinal standard doit être appliqué, pour l’enfant et son entourage familial. Egalement, la vaccination est fortement recommandée :
- contre la grippe à partir de l’âge de 6 mois (dès la mise à disposition en pharmacie) ;
- contre le pneumocoque (selon la recommandation du médecin) ;
- contre la covid-19.
Chez les enfants recevant un traitement immunosuppresseur, les vaccins vivants atténués (i.e. ROR, BCG, rotavirus, VZV, fièvre jaune, dengue, vaccin nasal contre la grippe) sont contre-indiqués. Si le traitement immunosuppressif peut être reporté, il est conseillé de réaliser ces vaccins avant de commencer le traitement en suivant les recommandations des autorités sanitaires.
Relecture par le Pr Christophe Delacourt, pneumologue, coordonnateur du centre de référence des maladies respiratoires rares de l’enfant (RespiRare), Hôpital Necker Enfants malades, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, création juillet 2025.